Cabinet de recrutement de Cadres Dirigeants et Fonctions Corporates
Dans un environnement des affaires et des technologies en évolution rapide, les fonctions corporates des entreprises doivent se réinventer pour répondre aux défis futurs. Cette mutation pourrait avoir une influence déterminante sur la réussite des entreprises et influencera la recherche et la sélection des futurs dirigeants d’entreprise.
FITCH BENNETT Partners accompagne les gouvernances d’entreprise à recruter en France comme à l’international les nouveaux leaders de demain, à développer leur performance collective et à les coacher sur la transition managériale à mener. Fitch Bennett Partners met également à disposition des dirigeants d’entreprise des managers de transition expérimentés dans ces fonctions corporate pour développer leur compétitivité.

Les enjeux des métiers verts et notre expertise dans le recrutement RSE
Avec l’essor de l’économie verte, des secteurs stratégiques vont connaître une transformation importante dans leur organisation et dans leurs métiers (source Organisation internationale du travail).
Prenons pour exemple : l’agriculture, l’industrie forestière, la pêche, l’énergie, l’industrie manufacturière fortement consommatrice de ressources, le recyclage, le bâtiment ou encore les transports.
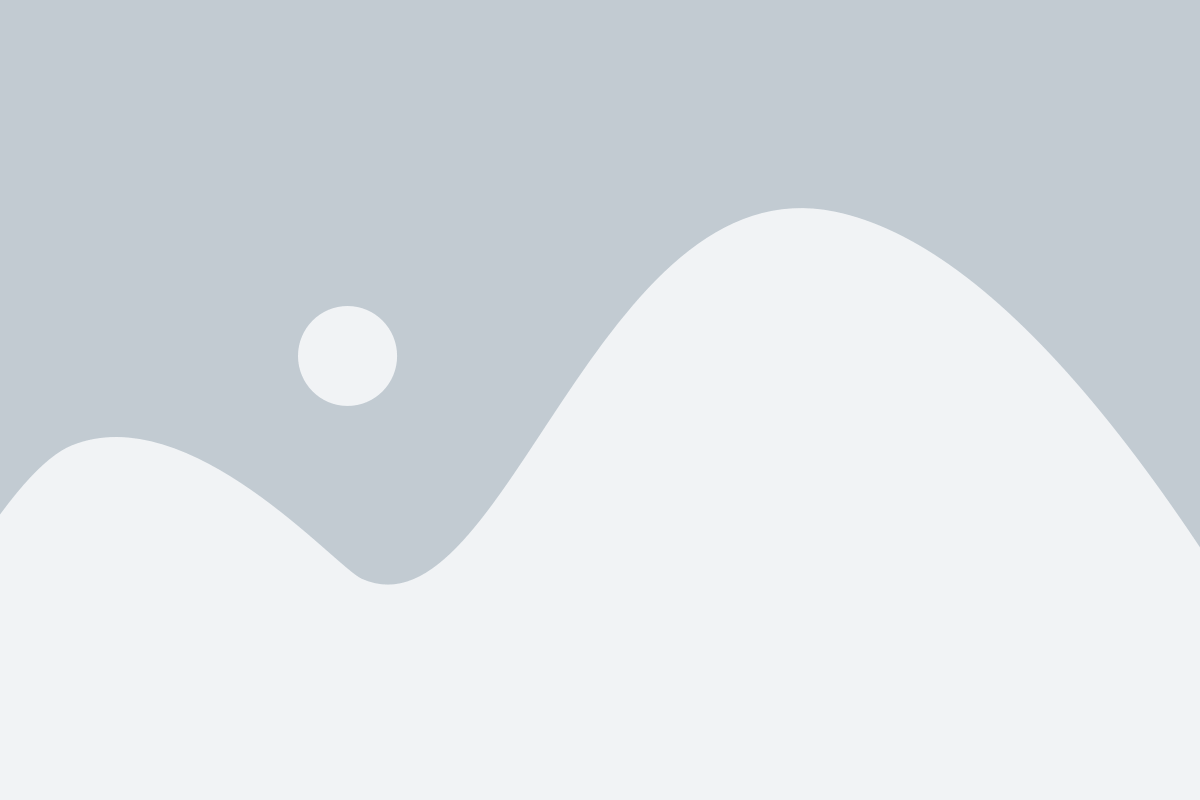
Les enjeux pour les cadres dirigeants
La nécessité d’une plus grande agilité et flexibilité dans un contexte d’accélération du changement devrait conduire à une évolution des structures organisationnelles, favorisant le travail d’équipe collaboratif et innovant.
Les fonctions corporate de demain seront bien différentes de celles d’aujourd’hui. Elles devront s’adapter rapidement à l’évolution des tendances et jouer un rôle clé dans le pilotage de l’innovation et du changement au sein des entreprises.
Les practices couverts par nos professionnels spécialisés dans les Fonctions Corporates
Direction générale
Direction de Business units, filiales, pays
Direction juridique et fiscale
Direction de la RSE
Direction des systèmes d’information
Direction de l’organisation
Direction de la transformation
Direction des ressources humaines
Direction des achats / supply chain
Direction de la communication
Secrétariat général
Le cabinet de conseil en recrutement Fitch Bennett Partners accompagne au quotidien les entreprises dans le recrutement par approche directe, le management de transition et la gestion de carrière de dirigeants et d’experts en France et à l’international.
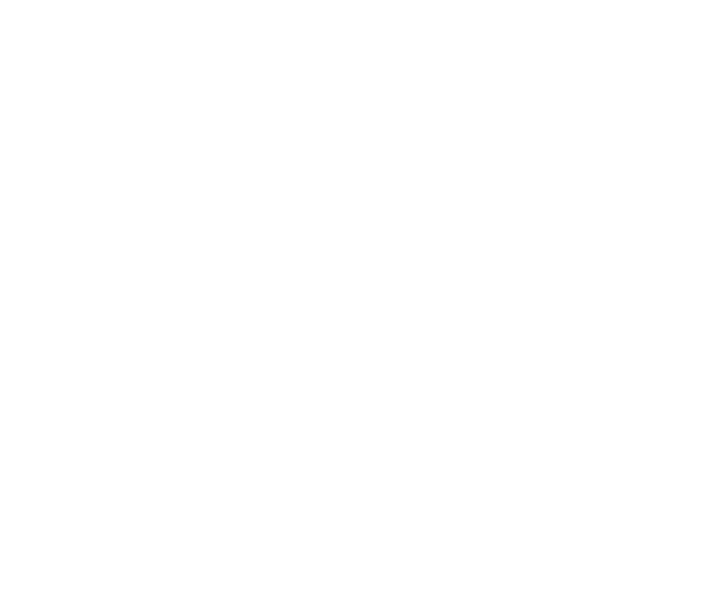
- societes@fitchbennettpartners.com
-
242, Boulevard Jean Jaures
92100 Boulogne Billancourt - +33 1 84 79 02 44
MENTIONS LÉGALES │PRESSE │ PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES © FITCH BENNETT PARTNERS – TOUS DROITS RÉSERVÉS
2025- PROPULSÉ PAR UNITEED MEDIA
Le cabinet de conseil en recrutement Fitch Bennett Partners accompagne au quotidien les entreprises dans le recrutement par approche directe, le management de transition et la gestion de carrière de dirigeants et d’experts en France et à l’international.
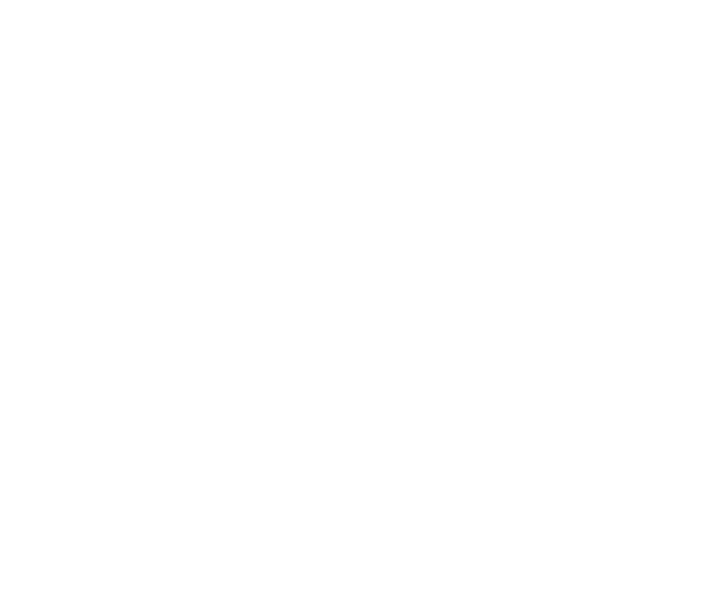
- societes@fitchbennettpartners.com
-
242, Boulevard Jean Jaures
92100 Boulogne Billancourt - +33 1 84 79 02 44
MENTIONS LÉGALES │PRESSE │ PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES © FITCH BENNETT PARTNERS – TOUS DROITS RÉSERVÉS


